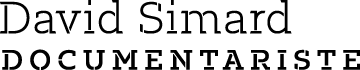Pouvoir oublier – Documentaire sur le Front commun de 1972
« Les technocrates promettaient la liberté. Les syndicats aussi. Ils ont écrit l’histoire sur des cendres encore brûlantes. »
Texte de l'affiche promotionnelle
Après les salles, après les passages télé, Pouvoir oublier revient. En accès libre, offert à quiconque veut s’y risquer. Non plus dans la ritualité d’une projection, mais dans l’errance numérique. Une dérive qui prolonge la vie du film, mais sous un régime incertain.
https://www.youtube.com/watch?v=IxFdlbMAWKw
Beaucoup pleurent la mort des salles. Moi, enfant d’Internet, mes distractions comme mes hauts savoirs ont été arrachés par des pirates qui refusaient d’en être les clients. Toute une jeunesse s’est abreuvée ainsi dans les années 2000. Les voyous reprenaient, de force si nécessaire, ce que l’humanité produit pour elle-même, par un élan irrésistible de vie. Au-delà de la propriété, des auteurs, des producteurs, de tous ceux qui figurent en haut du générique.

Dès le départ, ce projet de film sur le premier Front commun intersyndical québécois portait une contradiction dont le titre est l’incarnation. On aime les injonctions à la mémoire, fut-elle cribler de mysthifications. Or, filmer la mémoire, c’est enregistrer son effacement. Chaque image — même une archive de 1972 placée dans un montage artistique — fixe son propre effritement, comme une ruine au moment même de sa construction. Benjamin parlait de l’histoire comme d’un amas de débris saisis dans l’instant d’une catastrophe. Adorno se méfiait de toute réconciliation facile avec le passé. Et nous, nous voulions faire tenir ensemble mémoire et oubli, archive et disparition, utopie et défaite. Et cette révolte de Sept-Îles comme image de la catastrophe que plus personne ne sait voir, alors qu’elle s’abat sur nous inlassablement.
Le titre Pouvoir oublier, proposé par Pierre-Luc, contesté de toutes parts, reste pour moi d’une force intacte. Il ne s’agit ni d’effacer ni d’exorciser, mais d’assumer le paradoxe. Ceux qui refusent l’ironie du sujet faiseur d’histoire, qui réclament un récit cohérent, lisse ou édifiant, sont déjà les plus grands amnésiques. Filmer, c’est se perdre dans un nouveau monde. Créer de nouveaux mythes. Montrer, c’est disparaître — derrière l’œuvre, sous l’histoire, dans l’accueil de la destruction prochaine de ces paysages qui furent jadis faussement les nôtres.
La lutte des classes se poursuit sans son nom. Ses éclats résonnent encore, mais sous d’autres vocabulaires. Ses exploits, jamais aussi glorieux qu’on le prétend, se sont dissous dans les sables mouvants de la gestion, du réalisme, du spectacle. Reste une mémoire lourde, parfois insupportable, que nos thérapeutes du ressentiment — nationalistes, populistes, réactionnaires — appellent force, mais qui n’est peut-être qu’un symptôme de leur défaite consacrée sous le rouleau compresseur du Progrès. Le Front commun se répète, éternel recommencement, mais sans rêve d’émancipation, par-delà les quelques dollars de plus. Sans nouveauté, donc sans force.
Nous pourrions dire que les mauvais jours finiront. Mais pas sous cette forme, soyez-en certains.
On pourrait me demander, avant de poursuivre quelconque réflexion : quel est le positif de la destruction des communautés, celle du cinéma comme celle du Front commun ? Je répondrais : la naissance d’un regard différent, plus léger, plus jeune. Le spectateur dans le cyberespace n’a plus les certitudes, ni la morale des institutions, ni le bavardage sociologique. Son geste de distinction — si c’est bien de cela qu’il s’agit — carbure aux formes originales. Il ne peut compter que sur son appétit immédiat, sur la secousse de ce qu’il voit. S’il n’y a pas de choc esthétique, il n’y a rien.
Bien sûr, ce goût est façonné par la civilisation. Mais son isolement le livre à une expérience nue, presque sans défense. Dans ce dénuement, il peut inventer, recomposer, bâtir un système à sa mesure. Ou n’en bâtir aucun.
Alors voilà. Pour ce spectateur qui dérive, trop d’histoire paralyse. Trop de mémoire condamne à l’impuissance. L’émerveillement délivre de la lourdeur des héritages, des défaites ressassées, des victoires usées. Ce film est voué à s’éteindre dans d’autres mémoires inconnues. Qu’il s’efface, pour que surgissent d’autres forces. De nouvelles forces. Espérons incontrôlables.